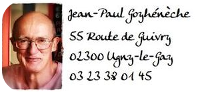UGNY LE GAY
Le site de l'électron libre
La forêt se meurt...




«La situation est assez menaçante», confiait, l'air soucieux, la vice-présidente de la fédération nationale des syndicats forestiers le 10 mars 2020 lors d’une conférence nationale sur les problèmes du réchauffement climatique.
Et pour cause: depuis plusieurs dizaines d'années, les menaces qui pèsent sur les forêts françaises se multiplient à mesure que la température globale augmente. Faisant craindre aux forestiers et sylvophiles que la santé des forêts ne se dégrade dramatiquement.Parmi les raisons de cette inquiétude, on retrouve en premier lieu la multiplication en nombre et en intensité des épisodes de sécheresse et de canicule, qui mettent en péril la capacité de régénération des forêts. La hausse du mercure et le stress hydrique poussent en effet les arbres à entrer en compétition pour l'eau, ce qui perturbe leur croissance, voire les fait périr.
Des vagues de chaleur dévastatrices...
Les épicéas, les hêtres, les sapins et les pins sylvestres sont particulièrement exposés: depuis 2019, ces essences ont connu une mortalité exceptionnelle, notamment en Lorraine et dans le Massif Central, régions où elles étaient jusque-là bien adaptées. Les arbres réagissent de manière quasi-identique: ils jaunissent, rougissent, et perdent leurs feuilles avant de mourir. «C'est quelque chose que l'on n'a jamais observé de mémoire de forestier», confesse Philippe Gourmain, président des Experts Forestiers de France, également présent lors de cette conférence.Depuis deux ans, les forêts du Nord-Est souffrent particulièrement de ces vagues de chaleur. Une étude menée, entre autres, par l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement (INRAE) et l'Office nationale des forêts (ONF) a également montré que la sécheresse estivale était le premier facteur de mortalité des pins dans les forêts de dunes d'Aquitaine. Les forêts méditerranéennes, qui couvrent 4 millions d'hectares, sont elles aussi aux premières loges. «Cet été, il a fait jusqu'à 43°C dans l'Hérault,» précise Charles Dereix, président de l'association Forêt méditerranéenne. À ces niveaux de chaleur, on observe des phénomènes de cavitation, la sève ne circule plus et l'arbre meurt. Ça a été le cas pour des chênes verts dans la région.»
Des conditions favorables aux scolytes et aux incendies.
Conséquence de cette hausse des températures : les forêts dépérissent, ce qui les rend beaucoup plus sensibles aux attaques des insectes cambiophages. Les forêts d'épicéas du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté sont ainsi touchées depuis 2018 par une prolifération de scolytes, un insecte qui s'attaque aux troncs des arbres affaiblis et déshydratés. «Les scolytes ne subissent pas la chaleur, mais en profitent, avec trois cycles de reproduction au lieu de deux», explique Philippe Gourmain. Les forêts de l'Ain, de Normandie et de Picardie sont également touchées.Les sécheresses et canicules ne font pas qu'affaiblir les forêts : elles créent également des conditions favorables aux feux de forêts, et augmentent la vulnérabilité des massifs. «La question n'est pas ‘‘est-ce qu'il y aura des mégafeux similaires à ceux qu'il y a eu en Australie?'', elle est bien ‘'où et quand ?''», s'alarme Charles Dereix. L'augmentation en nombre et en intensité des feux de forêts représente un risque, non seulement pour la biodiversité, mais également pour les populations humaines en raison de l'urbanisation des territoires adjacents aux forêts, 1,5 million de résidents sont situés dans une zone à risque important.
Une situation qui pourrait s'aggraver dans les prochaines décennies
La situation est d'autant plus alarmante que ces phénomènes vont, selon toute vraisemblance, s'intensifier dans les années à venir sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Selon les conclusions du rapport Jouzel de 2014 sur le climat futur en France, les températures moyennes augmenteront de 0,6 à 1,3°C d'ici 2050, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour certaines essences peu adaptées à un tel climat. Selon un rapport interministériel s'appuyant sur les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), près de la moitié des landes et des forêts métropolitaines sera concernée par un niveau élevé de l'aléa feux de forêts à l'horizon 2050, contre un tiers aujourd'hui.La nécessité d'adapter les forêts au dérèglement climatique
Afin de réduire l'impact du dérèglement climatique sur les forêts, plusieurs méthodes existent. Depuis 2011, l'ONF mène une expérience de migration assistée des essences, baptisée «Projet Giono». L'idée est de sélectionner des chênes et des hêtres bien adaptés au climat du sud de la France, afin de les replanter plus au nord. Le projet n'en est encore qu'à ses débuts, mais cette stratégie de substitution par des essences plus conformes au climat futur fait partie des stratégies d'adaptation.Une situation qui pourrait s'aggraver dans les prochaines décenn En partenariat avec le Centre national de la propriété forestière (CNPF), l'ONF teste également la résistance du sapin Bornmuller dans la région Grand Est. Cette espèce n'a besoin que de 30 mm d'eau par mois pour survivre en été. Elle pourrait donc s'avérer plus résiliente que les essences actuellement plantées dans la région. Des stratégies d'adaptation plus douces, comme le mélange d'arbres de différentes espèces et âges, au détriment de la monoculture, sont également prometteuses, note Charles Dereix.
Afin de limiter le stress hydrique des arbres, il est également possible de réduire la densité d'arbres plantés sur une même parcelle. Il est cependant préférable de s'abstenir de réaliser des coupes rases, précise Charles Dereix, afin d'éviter de mettre en lumière le sol. Réaliser de simples éclaircies permet en effet de limiter la compétition pour l'eau tout en maintenant la couverture forestière, qui permet de garder le sol à l'ombre, et empêche donc le développement d'une végétation concurrente.
Si des solutions existent, elles demeurent cependant, pour l'heure, insuffisamment mises en place, notamment par les forestiers privés. Quoique 80 % d'entre eux soient conscients du dérèglement climatique, selon une récente enquête interne, une minorité est décidée à «faire quelque chose». Ils n'y voient pas très clair sur le sujet, et ils ont aussi l'idée que la réglementation va beaucoup les contraindre. Ils n'ont pas l'argent pour entreprendre de la gestion améliorative ou de replantation dans la forêt. Les pouvoirs publics doivent accompagner le financement des travaux d'adaptation des forêts. Le ministère de l'Agriculture prépare actuellement une feuille de route sur le sujet. Reste à voir si les demandes des forestiers privés seront entendues.