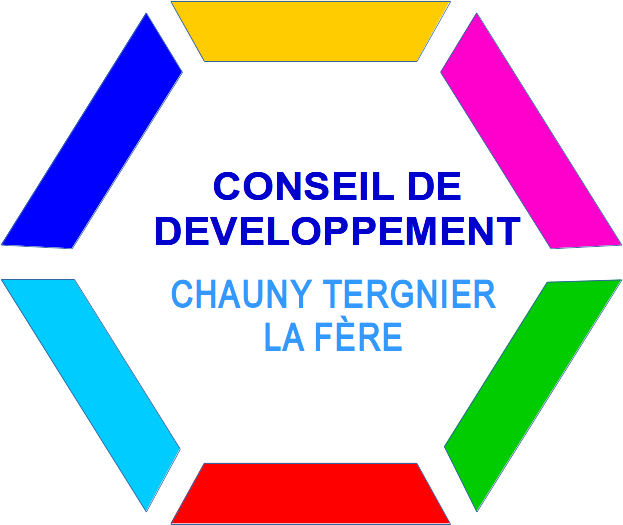
Les avis du CoDev.
Avis sur le projet de territoire.
Le projet de territoire regroupe 5 orientations stratégiques déclinées en 20 axes prioritaires regroupant 67 actions.
Sa mise en œuvre relève d'un nombre important d’intervenants tant internes qu’externes sur une durée de 10 ans
pendant laquelle les environnements locaux, régionaux et nationaux vont
évoluer que ce soit dans les domaines, économiques, sociaux, fiscaux, environnementaux, etc..
Durant cette période de 10 ans entre 2019 et 2029, il relève de la responsabilité du Conseil Communautaire de suivre de façon périodique (à minima annuellement)
l’état d’avancement des différentes actions et leurs impacts concrets sur le territoire afin de pouvoir tant que de besoin :
_1 S'assurer de la mise en œuvre du projet validé par ses soins par la prise en charge effective des actions par les responsables identifiés pour leur mise en œuvre,
du respect des échéances souhaitées, de la bonne coordination entre les différents acteurs internes et ou externes.
_2 Arbitrer les sujets le nécessitant (budgets, moyens humains et/ou matériels, délais, objectifs, etc…)
_3 Adapter et faire évoluer le projet de territoire notamment en arbitrant, réorientant, complétant ou abandonnant
des actions ou projets au regard des évolutions constatées sur l’environnement, des opportunités, difficultés ou coûts de leurs mises en œuvre.
_4 Solliciter des analyses et avis externes dont le Conseil de développement.
_5 Communiquer sur la mise en œuvre et les résultats obtenus que ce soit en interne en direction des collaborateurs de la Communauté
d’Agglomération qu’en externe vis-à-vis des administrés.
A cet effet, nous recommandons au Conseil Communautaire de s'assurer que la procédure de pilotage, de gestion, d'animation et de suivi du Projet de territoire existe de façon
suffisamment formalisée et détaillée et couvre notamment de façon non exhaustive :
• Les modalités d’attribution des actions à mettre en œuvre à des responsables nommément identifiés
• Les instances et circuits de validation des modalités de mises en œuvre détaillée des différentes actions (Moyens humains, matériels et budgétaires ;
définition des livrables attendus, planification des étapes et échéancier).
• La définition d’objectifs de moyens et de résultats tant quantitatifs que qualitatifs aux niveaux le mieux adapté (Actions, axes prioritaires,
orientations stratégiques) permettant de mesurer le résultat et les impacts des actions mises en œuvre.
• Les modalités de restitution de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet de territoires et d’atteinte des objectifs définis (instances, fréquence, etc…).
• Les modalités de communication interne et/ou externe (publics, fréquences, format, canaux, etc.. ).
Afin de pouvoir remplir ses missions auprès du Conseil Communautaire, le Conseil de développement souhaite être destinataire à minima annuellement d'une synthèse
du niveau de mise en œuvre des actions du Projet de territoire, du niveau d'atteinte des objectifs fixés ainsi que des modifications apportées au Projet de territoire.
Avis sur le PCAET.
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), comme son prédécesseur le PCET,
est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique,
de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie.
Outre le fait, qu’il impose également de traiter le volet spécifique de la qualité de l’air (Rajout du « A » dans le signe),
sa particularité est sa généralisation obligatoire à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 habitants
à l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour les intercommunalités de plus de 50.000 habitants.
Il peut être de nature assez différente en fonction de l’engagement des collectivités concernées, mais son contenu est fixé par la loi :
_un diagnostic,
_une stratégie territoriale,
_ un plan d'actions
_ un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées.
Les déclinaisons de ce nouvel outil réglementaire ne sont pas sans rappeler les dispositions des démarches Agenda 21.
Le PCAET doit également prendre en compte dans son élaboration le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
permettant ainsi d’intégrer les dispositions relatives à un urbanisme (mobilités, consommation d’espace, respect de l’armature urbaine, …)
Avis sur le bilan du Projet de territoire
La circulaire du 1er Ministre du 12 février 1999 précise que «l'évaluation d'une politique publique
consiste à comparer ses résultats aux moyens qu'elle met en œuvre, qu'ils soient juridiques, administratifs
ou financiers et aux objectifs initialement fixés. Elle doit aboutir à un jugement partagé sur l'efficacité de cette politique».
La Société Française de l’Évaluation en précise le contenu:«Évaluer une action c'est juger de sa valeur. Évaluer une action publique
c'est juger de leur valeur au regard de critères préalablement explicités et sur la base d'informations rassemblées et analysées à cet effet.
L'évaluation doit permettre la compréhension d'ensemble de la politique étudiée, l'appréciation globale de ses effets et du degré d'atteinte
de ses objectifs et enfin la pertinence et l'efficacité des ressources mobilisées pour sa mise en œuvre. Les conditions dans lesquelles se
réalise une évaluation doivent permettre de répondre à la double exigence d'une expertise indépendante, à savoir:
_un regard extérieur porté sur la politique évaluée...
_une prise en compte équitable des points de vue de ses décideurs, de ses acteurs et de ses bénéficiaires.»
Trois facteurs de réussite sont nécessaires pour réussir cette évaluation. Prévoir les temps suffisants pour s'impliquer et participer à l'évaluation.
Les élus et les techniciens mais aussi les bénéficiaires doivent savoir qu'il faut qu'ils participent et consacrent du temps à l'évaluation.
Réussir l'évaluation, c'est aussi favoriser le croisement des regards donc dans la mesure du possible ouvrir le cercle des personnes et des acteurs interpellés.
Ceci renvoie à nouveau à la préparation et la mise en forme d'une information objectivée leur permettant d'être acteur de l'évaluation.
C'est aussi, par exemple, organiser la rencontre, les échanges entre les bénéficiaires, les maîtres d'ouvrage et acteurs potentiels pour aller en particulier
vers les préconisations mais aussi favoriser l'émergence de nouveaux projets...
*
Faire en sorte que l'évaluation débouche sur des préconisations dont les liens de causalité sont clairement établis
avec les éléments d'analyse, avec les enseignements de l'évaluation.
C'est également comprendre que les préconisations "appartiennent" à l'évaluateur...



